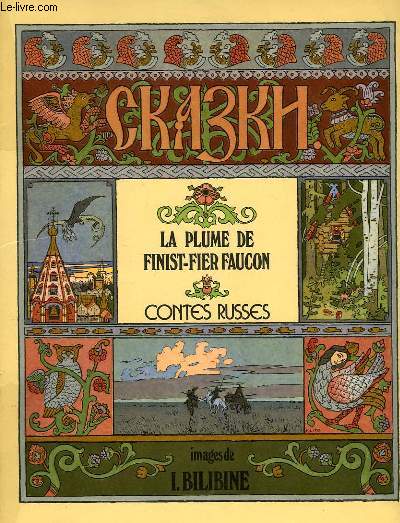« Pour moi une journée passée sans quelque chose qui n’est pas posé, dans un cahier, n’existe pas. J’ai besoin de passer par l’écrit. »
Si certains l’ont, comme moi, découverte au cinéma dans Les Misérables, tourné en 1995, c’est au théâtre que Salomé Lelouch construit une carrière singulière et exigeante, à l’image de la programmation du Ciné 13 Théâtre, dont elle est à la tête depuis 2003. Tour à tour comédienne, productrice et programmatrice, c’est en tant que dramaturge que Salomé Lelouch excelle, qu’elle évoque la quête identitaire, les relations familiales ou les tourments amoureux. Après le succès de sa dernière pièce Politiquement correct, Salomé Lelouch participera le samedi 07 janvier à la sixième édition du Paris des femmes, avec une création, A plusieurs, autour du thème du scandale. Cette touche-à-tout qui semble n’aimer rien tant qu’interroger et pousser les limites du spectateur nous a accordé une interview. Elle y apparaît comme une instinctive, persuadée que ses lectures, les thèmes de ses pièces, les rencontres artistiques qu’elle fait la choisissent plus qu’elle ne les choisit.
Salomé Lelouch, quelle lectrice êtes-vous ?
Je suis une lectrice relativement compulsive. J’ai de périodes où je lis énormément, puis des périodes où je lis très peu, puis je me remets à lire. Mais en général je lis toujours deux à trois romans en même temps, et il n’est pas rare que l’un prenne le pas sur l’autre, que l’un soit réservé au métro, l’autre au soir. J’ai lu beaucoup de classiques, et je crois que mon plus beau souvenir qui leur est associé est la découverte des Rougon Macquart. Je me souviens d’avoir un jour décidé de les relire dans l’ordre. Je garde un souvenir très particulier de Chateaubriand et des Mémoires d’outre-tombe. J’avais commencé par Les Morceaux choisis, avant de lire Les Mémoires en intégralité. Je dois avouer que j’ai un rêve, celui d’arriver à rentrer un jour, véritablement, dans l’œuvre de Proust. J’ai dû essayer une dizaine de fois, sentant bien qu’il y avait une langue, un rythme, une esthétique, me disant à chaque fois « ça y est, je suis rentrée dans son univers », avant de devoir renoncer, comme si quelque chose résistait, un peu comme quand vous avez le sentiment que ce n’est pas le bon moment dans votre vie.
En littérature contemporaine, ce sont plus souvent les sujets qui m’attirent, que les auteurs, et je suis une lectrice assidue de romans historiques, ou d’enquêtes. J’aime les enquêtes, Les recherches, ces univers-là. Il y a des écrivains que j’aime beaucoup bien sûr, comme Karine Tuil, Emilie Frèche ou Serge Joncour par exemple, mais ce sont plus des thèmes qui m’attirent vers un auteur, puis un autre. Je lis bien sûr du théâtre pour mon travail, mais c’est encore autre chose.
Votre travail de dramaturge influe-t-il sur la lectrice que vous êtes ?
Forcément un peu. Il y a des périodes, essentiellement lorsque je n’écris pas, où j’ai un réel besoin d’être nourrie, d’être inspirée par mes lectures. La qualité du texte, son souffle, est alors aussi importante sinon plus que l’histoire racontée. En période d’écrire – car je continue à lire lorsque j’écris – la lecture doit être pour moi une récréation, comme un sas de décompression. Il s’agit alors d’être portée par le thème. Pour répondre à votre question, je pense, bien sûr, que mes lectures influent sur mon travail d’écrire, mais ce n’est jamais très clair. L’écriture part d’une recherche, d’un sujet qui intéresse, mais comme j’écris du théâtre – qui est une forme particulière d’écriture -, et que je lis essentiellement du roman, je n’ai pas toujours l’impression que les deux soient liés. Et j’aime cette idée que la lecture reste une espèce de sas.
Comment l’écriture théâtrale s’est-elle imposée ? Parce que vous étiez metteur en scène ?
Tout à fait. J’avais un rapport fort au plateau, je produisais des pièces, j’en programmais et en avais jouées j’ai d’ailleurs arrêté la comédie quand j’ai senti que j’avais envie de devenir metteur en scène… L’écriture théâtrale a donc naturellement dérivé de tout ça. Mais j’ai toujours écrit. J’ai toujours tenu de grandes correspondances, je suis toujours passée par l’écrit, et pour moi une journée passée sans quelque chose qui n’est pas posé, dans un cahier, n’existe pas. J’ai besoin de passer par l’écrit.
Et irez-vous un jour vers d’autres formes d’écriture ?
Oui. J’en ai très envie. J’ai commencé des romans, des nouvelles, des choses comme ça, mais j’ai le sentiment que l’écriture romanesque est quelque chose qui m’imposerait de partir longtemps, d’être complètement immergée, et pour plein de raisons purement professionnelles, je n’ai pour l’instant pas l’occasion d’avoir des journées entières consacrées à l’écriture. Pour le théâtre, au contraire, je trouve qu’il y a quelque chose de très agréable à s’évader une heure, se poser dans un café, écrire, se mettre dans la peau du personnage. J’ai l’impression que les scènes théâtrales sont très présentes, très ancrées, qu’elles peuvent surgir à n’importe quel moment. Alors que l’écriture romanesque, qui nécessite de rentrer dans un souffle, et d’avoir une vision très claire de où est-ce qu’on va, me demanderait vraiment une autre disponibilité.
Votre pièce À plusieurs sera jouée sur la scène du Paris des Femmes samedi 07 janvier. Pouvez-vous nous en parler ?
Le thème de cette nouvelle édition est « Scandale », qui est un thème large. J’ai décidé de d’écrire sur une mère et son fils, et sur un rapport, comme je trouve qu’il en existe de plus en plus aujourd’hui, entre des gens de la génération au-dessus de nous, qui ont l’air plus libres, qui ont moins de codes et semblent plus ouverts, et des gens de notre génération, qui ont tendance à avoir un discours plus radicalisé, à se durcir. Je voulais explorer ce rapport-là. Et le scandale naît de la découverte d’une sexualité débridée d’une mère par son fils, un jeune homme de 21 ans.
Connaissez-vous la distribution ?
Brigitte Rouan joue le rôle de la mère, Sylvain Sounier joue celui du fils. Manon Combes fait également partie de la distribution. Mais il faut savoir qu’au Paris des Femmes, on ne choisit ni le metteur en scène, ni les acteurs. On livre le texte et c’est Anne Rottenberg, la directrice du Paris des Femmes, qui choisit les metteurs en scène et acteurs.
La représentation sera donc une surprise pour vous ?
Oui, et c’est la première fois que cela m’arrive, de ne pas mettre en scène un texte que j’ai écrit, de ne pas choisir mec acteurs, et je trouve cela très agréable. Il y a bien sûr un petit côté angoissant parce qu’on ne maîtrise pas tout quand on est metteur en scène, on aime bien maîtriser, mais je suis curieuse de voir si ce texte va finalement raconter quelque chose qui va m’échapper. Les textes nous échappent forcément un peu lorsqu’ils sont interprétés, et je les découvre forcément d’une autre façon quand ils sont dans la bouche des acteurs, mais quand je mets en scène, je donne une impulsion. Ici, c’est différent. Vais-je sortir consternée en me disant « ce n’est pas du tout ce que j’ai voulu dire » ou alors ravie en me disant « ce n’est pas ce que je voulais dire mais c’est magnifique, c’est plus intéressant que ce que à quoi j’avais pensé » ? Donc pour toutes ces raisons c’est une expérience à laquelle je suis ravie de participer. Je suis aussi très contente que ce soit fait sur un festival court, le temps d’une soirée de représentation, pour un moment spécifique.
Puisqu’on aborde ce sujet, écrivez-vous pour des acteurs particuliers ? Choisissez-vous à l’avance vos distributions ?
J’ai eu besoin d’écrire mes premiers textes de théâtre pour des personnes précises, mais j’arrive aujourd’hui à écrire dans l’absolu. Mais parfois on écrit pour personne et il arrive, au cours de l’écriture, qu’une personne arrive et s’impose. C’est en tout cas difficile d’imaginer et de réécrire une pièce pour quelqu’un d’autre lorsque la personne à laquelle vous aviez pensé, pour laquelle vous aviez écrit, n’est plus disponible.
Parlez-nous de Politiquement correct, votre dernière pièce qui a rencontré un succès certain au théâtre de la Pépinière.
C’est un sujet que j’avais en moi depuis longtemps – je suis convaincue que les sujets vous choisissent, vous ne choisissez pas, tout comme les livres vous choisissent. Est-ce que l’incompréhensible peut être compréhensible, est-ce que l’on peut tomber amoureux de quelqu’un qui nous semble aussi éloigné de nous, voilà des questions que je souhaitais aborder. J’avais très envie que le personnage de Mado, cette jeune femme de gauche qui tombe sous le charme d’un militant d’extrême-droite, soit séduite, vacille, comprenne ses idées à un moment donné et se demande où est le problème, si tant est qu’il y en ait un. Moi-même en écrivant la pièce, en rencontrant des militants, j’ai été heurtée, parfois, dans mes convictions. Cela a été un vrai plaisir d’écriture, de rencontres, de questionnements. Et la pièce s’est d’ailleurs révélée plus politique que je ne l’avais imaginée. Repousser les limites du politiquement correct s’est révélé passionnant, drôle, théâtral. Et c’est avec cette pièce que j’ai vraiment découvert ce qu’était d’avoir des répliques qui un soir glacent la salle et celui d’après les font rire.
Politiquement correct a été l’aventure la plus « au bon endroit » de ce que j’avais envie de faire. La pièce raconte ce que j’avais envie de raconter.
Politiquement correct a-t-elle changé votre regard sur la politique ?
Oui. Je pense que j’avais auparavant des opinions qui étaient beaucoup plus liées à une éducation, une habitude, un milieu socio-culturel. Je me définis assez volontiers comme « bobo », mais sans le côté péjoratif que cela peut avoir car je trouve cela plutôt chouette, dans la vie globalement, d’être pour l’écologie, et je partage la plupart des idées ou combats des bobos. Néanmoins, je pense que les bobos ont un côté « sûrs de nous » très ancré, et écrire la pièce m’a poussée à me questionner. Pourquoi étais-je comme ça ? Pourquoi me définissais-je comme bobo ? Cela me paraissait naturellement juste, mais tant que je n’étais pas passée par le questionnement, quelque chose manquait, ou clochait peut-être. J’ai en tout cas rencontré des gens a priori très éloignés de moi dont je me suis sentie très proche, et d’autres qui auraient pu être beaucoup plus proches mais ne l’étaient en fait pas du tout. J’ai d’ailleurs parfois constaté que ceux qui parlaient de « vivre ensemble » n’étaient pas toujours les plus à mêmes à vivre ensemble ! Tout cela, toutes ces rencontres et réflexions m’ont emmenée dans des endroits que je ne n’aurais pas imaginés.
Pour finir, pouvez-vous nous parler d’éventuels projets à venir ?
Pour 2017, plusieurs événements, effectivement ! Je vais d’abord monter La tête des enfants, pièce que j’avais écrite avant Politiquement correct, et que je vais du coup peut-être retravailler. C’est une pièce qui sera beaucoup moins discutée, qui est moins clivante que Politiquement correct. Elle traite de la superstition, de la distinction entre foi et superstition, et de la difficulté d’être fidèle à ses idées lorsque quelque chose, au-dessus de nous, plane, vient nous empêcher d’avancer. On tourne encore une fois autour d’une histoire d’amour, celle d’un couple qui s’est juré dix ans de fidélité sur la tête des enfants. Le couple arrive au bout de ces dix ans. Que fait-on avec ce sentiment ?
Et enfin je suis en plein dans l’écriture de ma prochaine pièce !
A plusieurs, de Salomé Lelouch : samedi 07 janvier au Paris des Femmes