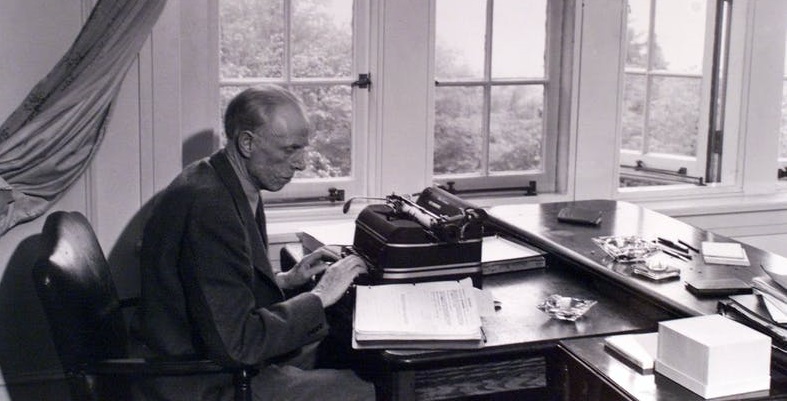J’ai d’abord besoin d’être séduite par l’existence même de l’écrivain pour créer un parfum. Les textes de Céline sont magnifiques, mais je n’en ferais jamais un parfum !
Femme passionnée et passionnante, Anaïs Biguine est la créatrice de Jardins d’écrivains, maison française de parfums et de bougies qui puise son inspiration dans la littérature classique. A mille lieues d’une banale tentative de récupération d’un patrimoine littéraire, Jardins d’écrivains se révèle une marque profondément sincère et authentique, qui propose une expérience audacieuse et renouvelle notre approche de la littérature. Le tout à des prix doux – Anaïs y tient ! Il nous fallait donc en savoir plus sur Anaïs Biguine et la genèse d’une marque au succès commercial plus que mérité, pour lequel nous avons eu un réel coup de cœur.
Entretien tout en « parfums et sons qui se répondent », comme dirait Baudelaire puisqu’Anaïs Biguine aura eu la générosité de me faire découvrir tous les parfums de Jardins d’écrivains…
Anaïs Biguine, quelle lectrice êtes-vous ?
Je lis assez peu d’œuvres contemporaines et je reste assez hermétique aux rentrées littéraires, à l’actualité éditoriale, même s’il m’arrive, bien sûr, de temps en temps, de me laisser embarquer. Je suis avant tout une lectrice de classiques, français comme étrangers, et essentiellement de classiques du XIXème siècle. Je suis viscéralement attachée à ce siècle, dans sa globalité ! Tout me fascine dans ce siècle. J’aime sa musique, j’aime sa mode, ses décors, ses découvertes, j’adore l’influence qu’a exercée l’affaire Dreyfus… J’aime tout, du début à la fin ! La littérature est alors pour moi un moyen de décrypter le quotidien, notamment chez les auteurs réalistes. J’imagine les bruits, les odeurs, les ressentis, n’importe où, le XIXème siècle et ses figures m’accompagnent. Je peux par exemple rester des heures durant à côté de George Sand, sur sa tombe. J’ai alors vraiment le sentiment non pas d’un dialogue qui appellerait des réponses – et je n’en ai pas, heureusement – mais d’une méditation, d’une rencontre qui réellement me nourrit. Ce sont des voyages intérieurs.
Comment la marque Jardins d’écrivains est-elle née ?
Jardins d’écrivains est née d’une visite de la maison de Hugo à Guernesey, Hauteville House. J’ai vécu un moment de grâce saisissant au sein de ce lieu. Je suis rentrée chez moi, dans mon manoir en Normandie, et c’est toujours pénétrée de ce moment que je me suis dit qu’il fallait que j’en fasse quelque chose. J’ai alors créé une gamme de bougies qui racontait les lieux de vie des écrivains, étant très attachée aux maisons, aux demeures, aux jardins, aux atmosphères et à la façon dont elles influent sur la création. Les maisons prennent soin de nous comme nous prenons soin d’elles.
J’ai donc commencé par Hugo, et d’autres bougies ont suivi. Il faut savoir que les bougies sont liées aux pièces à vivre. On ne met pas le même parfum dans un salon, une salle à manger ou une salle de bains. Ce qui est floral ou poétique comme Nohant correspond bien à la détente d’une chambre. La bougie Tolstoï, elle, par exemple, sera idéale pour une bibliothèque, un dressing d’hommes ou un fumoir. Certaines bougies plus gourmandes comme Maupassant vont très bien dans une cuisine. Les bougies sont donc liées à l’idée d’une signature olfactive dans une maison. Quelle empreinte olfactive souhaite-t-on laisser dans quelle pièce ?
Comment êtes-vous passée des bougies aux parfums ?
Forte de cette expérience, je me suis dit que j’allais faire des parfums, pour, après avoir abordé le lieu de vie de l’écrivain, évoquer son charisme, ou alors le mécanisme intime d’un personnage de roman.
George est le premier parfum que j’ai créé car je suis extrêmement attachée à George Sand et je souhaitais traduire olfactivement l’idée de cette femme qui s’impose dans un métier d’hommes, qui est très féminine tout en s’habillant en homme, qui se débaptise… Il y avait quelque chose à faire. Il y a une vraie générosité chez elle, et tout est passionnant chez George Sand. Pour traduire tout cela, j’ai eu l’idée d’une interprétation nocturne, d’une George Sand à Nohant, en phase d’écriture. Le parfum sent le café brûlé, le tabac, l’héliotrope, il a un côté très confiné en rapport avec le secrétaire qu’elle s’est créé dans une alcôve de sa chambre. C’est un parfum très puissant, mais le personnage est lui-même très puissant. J’ai donc fait un premier parfum sans avoir d’autres idées derrière la tête, d’autant que l’interprétation d’un parfum est un exercice difficile, différent de la création d’une bougie. Ce parfum a été extrêmement bien reçu. George m’a ouvert la voie.
Et s’en sont suivies d’autres créations…
Tout à fait. Il y a eu Wilde, qui est d’ailleurs en ce moment au Petit Palais, qui est un parfum un peu savonneux, propret, qui traduit l’Angleterre victorienne de Mayfair tout en ayant une inspiration grecque. Le parfum incarne le dandy. Il y a aussi Junky, qui est une interprétation de l’écrivain William Burroughs de la Beat Generation. Junky raconte qu’on a tous un rapport de dépendance au parfum. Burroughs est un dingue complet – je ne voulais pas m’attaquer à Kerouac, trop évident – et donc le parfum comporte des notes de canabis, mais aussi de bois sec. C’est une mécanique très précise, un parfum plus urbain que Wilde ou George. Junky a eu une sortie fracassante.
Orlando est un parfum que j’ai créé après avoir découvert l’adaptation cinématographique avec Tilda Swinton. Le livre de Virginia Woolf me tombe des mains, mais je voulais avoir l’honnêteté de dire qu’on pouvait aussi rentrer dans la littérature par autre chose que par le livre, par le cinéma mais aussi par le parfum. C’est un parfum oriental, au thème ancestral d’un Galia du 18ème siècle, et c’est une vraie rencontre olfactive. Ceux qui portent Orlando le portent très longtemps.
Marlowe, lui, raconte le mouvement baroque. Il est peu connu en France, ce qui me va très bien car je refuse de rentrer dans un panthéon scolaire. Je souhaitais aller vers un talent qui ne demande qu’à être populaire. C’est un parfum de fourrure, d’hiver, avec des tubéreuses, des fleurs séchées, du musc tonkin. Ce sont différentes facettes d’un cabinet de curiosité.
Gigi est un parfum très différent, bien plus léger. Il faut savoir que Colette est extrêmement importante pour moi. Son destin de femme m’émeut. C’est une femme forte, qui n’a pas froid aux yeux, mais sait aussi, avec Gigi, écrire des choses très légères. Gigi repose sur un instantané, sur le passage de la fille à le jeune femme. J’ai travaillé autour des fleurs blanches car Colette aimait les fleurs blanches, tout en y ajoutant du cassis. C’est un parfum solaire, d’été, très pétillant, qui convient aussi bien aux très jeunes femmes qu’aux femmes matures.
Enfin, le septième parfum, La Dame aux camélias, constitue mon plus gros succès commercial et c’est ma deuxième création. Il s’agit d’une cologne de nuit, et non d’un parfum, que j’ai présentée avec un flacon et une poire, en référence à l’activité du personnage et en hommage à une gestuelle particulière. J’ai travaillé sur le thème de l’amour, et j’ai voulu un côté floral avec une touche de cardamone qui vient perturber ce côté floral. Le succès de La Dame aux Camélias est dû pas uniquement au jus mais aussi à l’œuvre, qui est universellement très forte – je travaille avec quarante pays. Les Américaines adorent ce parfum…
A ce sujet, les ventes sont-elles les mêmes selon les pays ?
Non bien sûr ! Le Moyen-Orient aime Marlowe et Orlando qui correspondent à leurs repères olfactifs. En Asie, on aime Gigi et Wilde. Mes parfums sont en tout cas assez urbains et bien vendus en Europe. C’est en tout cas une marque qui a l’originalité d’être davantage connue par ses noms de parfums que par son nom de marque !
Combien de temps vous demande l’élaboration d’un parfum ?
Certains parfums sont plus évidents que d’autres, et je travaille sur plusieurs parfums en même temps. Six mois minium, un an environ. Il faut que le parfum vive, que je m’en imprègne, que je vive avec… Tout cela prend du temps.
Dans le processus créatif, vos lectures sont-elles orientées ? Ou guidées par le hasard ?
Mes lectures sont plutôt guidées par le hasard, car il ne faut surtout pas que je guide trop mes lectures. J’ignore quel sera le prochain parfum, même si en ce moment mes antennes sont sorties…Et c’est la lecture qui m’amènera sur des pistes. Néanmoins, lorsque j’ai une piste, je me replonge dans l’œuvre, la biographie, je me nourris littéralement. J’ai d’abord besoin d’être séduite par l’existence même de l’écrivain pour créer un parfum. Les textes de Céline sont magnifiques, mais je n’en ferais jamais un parfum ! (rires)
Votre amour de la littérature est plus qu’évident lorsque l’on vous écoute, mais pourquoi avoir créé une marque, quelque chose de commercial, finalement, autour de la littérature ? N’est-ce pas paradoxal ?
La littérature constitue pour moi une source d’inspirations immenses, mais j’ai un grand respect dans la façon dont je le traite. Les adaptations olfactives sont peut-être subjectives – chacun a sa propre perception de la littérature – mais je construis mes parfums. J’ai une réelle démarche d’investigation pour comprendre le mécanisme intime d’un personnage. Cela aurait été terriblement odieux pour moi qu’on considère cette marque comme une vaste entreprise de récupération. Cela aurait été terrible, mais cela reste néanmoins un sujet sensible. Parce que la lecture est quelque chose d’universel, que c’est une des rares choses accessibles à tous, et extrêmement enrichissante.
Comment arrivez-vous à vous renouveler sans tomber dans le systématisme ?
Je refuse de rentrer dans des évidences trop scolaires. Lorsque j’ai créé Marlowe, tout le monde s’est étonné et presque inquiété autour de moi (rires), mais j’ai tenu bon. A la limite, si j’avais créé un parfum Hugo, Zola ou Gavroche, que sais-je, tout le monde aurait été très content, mais je refuse de rentrer dans ce système-là, dans quelque chose qui pourrait sembler commercial, en tout cas non sincère. Je ne sais pas à qui va plaire ou correspondre mon parfum quand je le crée, et je ne veux pas le savoir. Je veux être fidèle à mon intuition artistique, et après qui m’aime me suive ! Je pense de toute façon que lorsqu’on est sincère, cela paie. Et c’est ce qui fait le succès de Jardins d’écrivains.
Pour en savoir plus : Jardins d’écrivains
Boutique Jardins d’écrivains : 15 rue des Tournelles, 75004 Paris