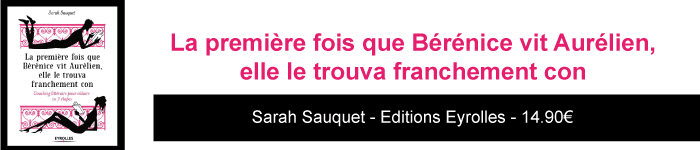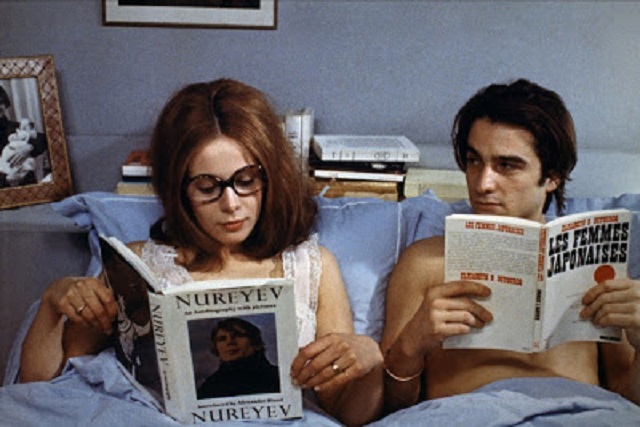Les scènes de repas sont un thème récurrent de la littérature classique, et ceci notamment à partir du XIXème siècle, grâce à l’essor du réalisme concomitant au développement des arts de la table. Véritable enjeu narratif, lieu d’expression du pouvoir mais aussi de la séduction, le repas est alors essentiellement abordé dans sa dimension nourricière ; les écrivains réalistes décrivant avant tout ce que l’on mange. Le contenu de ce repas révèle l’appartenance des personnages à un milieu social, et la façon dont ce repas est mangé, dégusté, appréhendé, dit bien des choses sur les relations qui unissent les convives.
Mais la scène de repas peut également être appréhendée dans une dimension purement esthétique. L’écrivain s’attarde alors sur les arts de la table, plus que sur les mets savourés. Une attention particulière est accordée aux matières (est-il question de faïence, de cristal, de porcelaine ?), aux couleurs (la table est-elle dressée dans des tons sourds, ou vifs ?) et aux sons (celui des verres en cristal ou des couverts en argent qui s’entrechoquent) ; et c’est à une véritable fête des sens que le lecteur est convié. Retour, sans plus attendre, sur les plus beaux services et les plus belles tables de la littérature classique…
Le service léger et cristallin de La Curée
« Entre ces pièces principales, les réchauds, grands et petits, s’alignaient symétriquement, chargés du premier service, flanqués par des coquilles contenant des hors-d’œuvre, séparés par des corbeilles de porcelaine, des vases de cristal, des assiettes plates, des compotiers montés, contenant la partie du dessert qui était déjà sur la table. Le long du cordon des assiettes, l’armée des verres, les carafes d’eau et de vin, les petites salières, tout le cristal du service était mince et léger comme de la mousseline, sans une ciselure, et si transparent qu’il ne jetait aucune ombre. »
Emile Zola, La Curée, 1872
L’argenterie du baron de Sigognac dans Le capitaine Fracasse
« La cavalcade rentra au château. Un somptueux repas, servi dans la salle où jadis le pauvre Baron avait fait souper les comédiens avec leurs propres provisions, n’ayant rien en son garde-manger, attendait les hôtes, qui furent charmés de sa belle ordonnance. Une riche argenterie aux armes de Sigognac étincelait sur une nappe damassée, dont la trame montrait, parmi ses ornements, des cigognes héraldiques. Les quelques pièces de l’ancien service qui n’étaient pas tout à fait hors d’usage avaient été religieusement conservées et mêlées aux pièces modernes pour que ce luxe n’eût pas l’air trop récent, et que l’ancien Sigognac contribuât un peu aux splendeurs du nouveau. On se mit à table. »
Théophile Gautier, Le capitaine Fracasse, 1863
Le service en faïence du Médecin de campagne
« La table était couverte d’une nappe de cette toile damassée inventée sous Henri IV par les frères Graindorge, habiles manufacturiers qui ont donné leur nom à ces épais tissus si connus des ménagères. Ce linge étincelait de blancheur et sentait le thym mis par Jacquotte dans ses lessives. La vaisselle était en faïence blanche bordée de bleu, parfaitement conservée. Les carafes avaient cette antique forme octogone que la province seule conserve de nos jours. Les manches des couteaux, tous en corne travaillée, représentaient des figures bizarres. En examinant ces objets d’un luxe ancien et néanmoins presque neufs, chacun les trouvait en harmonie avec la bonhomie et la franchise du maître de la maison. L’attention de Genestas s’arrêta pendant un moment sur le couvercle de la soupière que couronnaient des légumes en relief très bien colorés, à la manière de Bernard Palissy, célèbre artiste du XVIème siècle. »
Balzac, Le Médecin de campagne, 1830
La porcelaine de Sèvres d’Illusions perdues
« Le souper, servi dans une argenterie neuve, dans une porcelaine de Sèvres, sur du linge damassé, respirait une magnificence cossue. Chevet avait fait le souper, les vins avaient été choisis par le plus fameux négociant du quai Saint-Bernard, ami de Camusot, de Matifat et de Cardot. Lucien, qui vit pour la première fois le luxe parisien fonctionnant, marchait ainsi de surprise en surprise, et cachait son étonnement en homme d’esprit, de cœur et de style qu’il était, selon le mot de Blondet. »
Balzac, Illusions perdues, 1837
Les assiettes à petits fours dans A l’ombre des jeunes filles en fleurs
« Ils me rappelaient ces assiettes à petits fours, des Mille et une Nuits, qui distrayaient tant de leurs « sujets » ma tante Léonie quand Françoise lui apportait, un jour, Aladin ou la Lampe merveilleuse, un autre, Ali-Baba, Le Dormeur éveillé ou Simbad le Marin embarquant à Bassora avec toutes ses richesses. J’aurais bien voulu les revoir, mais ma grand-mère ne savait pas ce qu’elles étaient devenues et croyait d’ailleurs que c’était de vulgaires assiettes achetées dans le pays. »
Marcel Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, 1919
Le dîner aux chandelles de Bel-Ami
« On le fit monter au second étage, et on l’introduisit dans un petit salon tendu de rouge et ouvrant sur le boulevard son unique fenêtre. Une table carrée, de quatre couverts, étalait sa nappe blanche, si luisante qu’elle semblait vernie ; et les verres, l’argenterie, le réchaud brillaient gaiement sous la flamme de douze bougies portées par deux hauts candélabres. Au dehors on apercevait une grande tache d’un vert clair que faisaient les feuilles d’un arbre, éclairées par la lumière vive des cabinets particuliers. »
Guy de Maupassant, Bel-Ami, 1885
Vous souhaitez en savoir plus sur les scènes de repas dans la littérature ? Découvrez notre interview de Charles Roux, photographe qui reproduit les scènes de repas de la littérature !
Vous souhaitez découvrir d’autres scènes de repas de la littérature, notamment issues de Germinal ou L’Assommoir ? N’attendez plus pour télécharger l’appli Un texte Un jour !
Illustration : photo tirée de la série télévisée Downton Abbey (2010-2015) ©Carnival Films