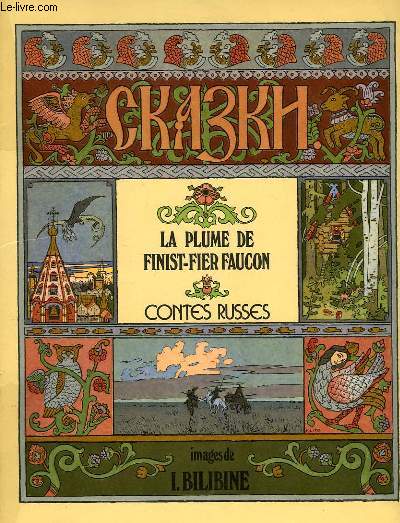« La part d’enfant reste très développée chez moi. Pourtant, en parlant à l’enfant, je me refuse à être infantilisant. C’est pourquoi j’ai conservé des termes un peu rares, des imparfaits du subjonctif et quelques structures de phrases qui réclament du jonglage. J’aime parler à l’intelligence des enfants, ils apprendront peut-être quelques mots, s’étonneront de quelques tournures, questionneront quelques rebondissements… et c’est tant mieux. »
A une période où la littérature jeunesse est commentée, mise en question, et parfois même censurée, écrire pour les enfants semble devenu plus que jamais un acte de résistance ! Si pour Christophe Honoré, « offrir un livre à un enfant, c’est confier cet enfant à un adulte que l’on ne connaît pas », nous ne pouvons que vous inviter à découvrir Hernig et Zebraël de Victor Boissel. Ce conte pour enfants à la fois onirique et délicieusement intemporel, écrit dans une langue choisie, est un ouvrage magnifique, aux illustrations chatoyantes, qui ravira petits et grands. Interview de son auteur, Victor Boissel.
Bonjour Sarah ;p
Victor, quel lecteur de classiques es-tu ou as-tu été ?
Très tôt je me suis trouvé dans le tout ou rien.
C’est-à-dire que soit j’étais complètement transporté et je prenais des coups à chaque page, soit je me sentais enlisé, empêtré voire piégé.
Ce qui me paraît délicat lorsqu’on lit un classique, c’est qu’il porte déjà ce titre, classique. Donc en l’abordant, on pose les doigts, les yeux et le cœur sur un héritage, sur un patrimoine, qui a déjà été reconnu comme noble, gracieux, profond, intelligent et j’en passe. Or, selon qu’on adhère ou non à la noblesse d’une œuvre, à sa grâce, à sa profondeur et à son intelligence, on peut marcher dans les pas de ses aînés ou fouler les massifs qui bordent l’allée.
Cela m’a conduit, dans mes plus jeunes années, à ne pas aborder les classiques d’une façon neutre, avec ma seule sensibilité, dès lors que j’étais à mon corps défendant le dépositaire des sensibilités de ceux qui avaient déclaré classiques les classiques.
« Comment, tu n’as pas aimé XXX ? » et pire : « Tu n’as pas compris, tu es passé à côté. »
Et ce venant de la part de profs, parents, amis.
Alors, pour répondre directement à ta question, je dirais que j’ai été et je suis un lecteur de classiques indépendant. D’abord j’ai été indépendant et pétri du complexe de l’usurpateur — celui qui doute de la pertinence de son regard sur un objet qui fait l’unanimité ; puis je suis devenu indépendant et libéré des héritages convenus — celui qui fait le tri des testaments qu’on lui présente comme des cadeaux.
Et c’est sur cette voie que j’ai réalisé qu’il n’appartenait qu’à moi de déterminer quelles oeuvres seraient mes classiques.
Y-a-t-il des classiques qui constituent tes livres de chevet ?
D’une façon générale, je suis très réceptif aux péripéties, à l’action qui produit la réflexion en laissant une place active au lecteur. Ce qui me vaut de m’attacher à des oeuvres comme L’épopée de Gilgamesh, L’Odyssée d’Homère, et à peu près tout ce qu’écrit Dumas, Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, Le Vicomte de Bragelonne, Le Comte de Monte-Cristo.
Ce sont des voyages que j’ai vécus comme des trajets en train à l’occasion desquels j’ai eu le loisir de prendre des notes riches d’enseignements sur les mondes qu’on me faisait découvrir et sur moi-même. Mais on ne prend pas des notes quand les rails du train prennent des formes de montagnes russes, on rit, on crie, on pleure et on jouit de la vitesse.
Et puisqu’il est question de Russie, j’ai une affection toute particulière pour Le Maître et Marguerite de Boulgakov. J’y ai trouvé les péripéties qui me sont chères ainsi qu’une grande dose de fantasmagorie et de liberté de ton, l’ensemble inscrit dans une structure exemplaire à mes yeux.
Et si je parle de structure, je pense également aux Misérables d’Hugo, une brillante inspiration quant à la construction des personnages et à la construction du récit.
Finalement, je vis la beauté du verbe comme un bonus, comme un plus, comme une épice bienvenue. Mais pour que ladite épice joue son rôle d’exhausteur de goût, il me faut d’abord un bon plat. Pour reprendre mon allégorie du voyage en train, je vois d’abord de l’intérêt dans les paysages que je traverse, même si je les observe depuis le wagon bringuebalant d’un vieux tortillard. Si de surcroît on m’offre une place en première classe d’un luxueux train équipé comme le Nautilus, c’est un bonheur supplémentaire.
C’est pour cela que — dans une autre famille de classiques — que j’aime Asimov sans que je lui trouve de grands talents purement littéraires. Je dis de lui, comme de Dumas, qu’il tourne les pages à ma place. Et toujours dans cette autre famille, je vois Dune d’Herbert comme une perle littéraire.
Enfin, parmi les classiques, j’ai aussi une inclination pour le théâtre. Britannicus de Racine — que j’ai toujours trouvé plus agréable à lire qu’à voir sur scène — et le vibrant Horace de Corneille qui m’a pris aux tripes et que j’ai eu la chance d’interpréter.
« Ma sœur, voici le bras qui venge nos deux frères,
Le bras qui rompt le cours de nos destins contraires,
Qui nous rend maîtres d’Albe ; enfin voici le bras
Qui seul fait aujourd’hui le sort de deux États ;
Vois ces marques d’honneur, ces témoins de ma gloire
Et rends ce que tu dois à l’heure de ma victoire. »
[Acte 5, scène 5]
Cela fait longtemps que tu écris, dans des genres et styles différents (je pense notamment à Habeas Corpus). Quand et de quelle façon t’es-tu lancé dans l’écriture ? Que t’apporte-t-elle ?
Un peu plus tôt j’évoquais L’épopée de Gilgamesh, connue comme étant la première littérature de l’humanité, eh bien ce récit a existé avant d’être un texte, il était transmis par tradition orale. Je crois que j’ai suivi cette voie. J’ai d’abord conçu des histoires qui se racontent, peuplées de toutes les figures de style du monde, puis j’ai commencé à les écrire, à les structurer, à les approfondir.
L’écrit permet d’agencer, de réagencer, de réécrire, de développer, de couper. Cela permet de produire des histoires plus soignées, plus finies. Écrire c’est le pouvoir de raconter des histoires à plus de gens qu’on ne peut en rencontrer. Soit qu’ils sont trop nombreux, trop éloignés ou, sait-on jamais, qu’ils ne sont pas encore nés. Peut-être qu’il y a là l’un des désirs de Gilgamesh, celui de la vie éternelle, non pas la vie physique et biologique, mais la vie d’idées, d’histoires, de voyages.
Il y a bien entendu une volonté de partage derrière l’envie d’écrire. Le partage d’observations, de raisonnements, d’émotions. Et si je suis volontiers un lecteur d’essais, j’apprécie l’intemporalité et l’image qui caractérise les histoires, j’aime m’attacher aux personnages et suivre leurs déambulations au bord de la falaise en m’inquiétant de les voir vaciller. Et c’est tout cela qui me fait écrire.
Depuis quand exactement ? Je l’ignore. Je sais qu’il y a eu des étapes. Petit, je racontais des histoires tout le temps, adolescent, je les écrivais, notamment dans des lettres que je photocopiais avant de les envoyer. Puis, à la fin de l’adolescence, mes correspondances sont souvent devenues électroniques et dès lors je gardais des copies manipulables de mes écrits. Et c’est en les manipulant que je me suis mis à produire des textes qui allaient bien au-delà des lettres, puis sont venus les autres, poèmes, nouvelles, textes libres, contes, romans, pièces, scénarios, textes de scène…
Aujourd’hui, on peut lire (voire écouter) quelques-uns de mes textes sur mon site : www.victorboissel.com
Et dans le commerce on trouve Habeas Corpus (2015) et Hernig et Zebraël (2016).
Tu viens de publier aux éditions Les Fourmis rouges Hernig et Zebraël, un conte pour enfants — et grands enfants. Comment la forme du conte s’est-elle imposée à toi ? Quel plaisir y trouves-tu ?
Je me demande si je ne passe pas mon temps à n’écrire que des contes, des histoires qui se racontent. Le conte, tel qu’on l’entend couramment, comporte une dimension simple ou infantile dans le regard porté sur l’histoire. Pourtant l’histoire ne l’est pas nécessairement. J’aime la candeur dans le regard. Le héros d’un conte est rarement un baroudeur, un briscard à qui on ne la fait pas. Il est plutôt jeune, candide, innocent et donc quelque part ignorant.
Je crois que je m’identifie à celui qui ignore, parce que c’est souvent celui qui cherche.
Quand j’étais enfant, je dévorais les contes, d’abord ceux qui étaient à la maison, Perrault, Grimm, Andersen, puis ceux qu’on trouvait à la bibliothèque, notamment des contes arabes, indiens, chinois. J’y trouvais des similitudes de structure ou de ton, de posture ou de morale. Il s’en dégageait une routine que je trouvais confortable sans qu’elle soit ennuyeuse. Puis, pour mes 10 ans, on m’a offert des contes russes traditionnels dont j’ai adoré l’atmosphère et la langue. On y trouvait les aventures de Vassilissa la subtile, Maria des mers et l’inénarrable Ivan Tsarévitch, aux prises avec Baba Yaga, qui dans un mortier voyage, du pilon l’encourage et du balai efface la trace, et le terrible Kotchéï l’Immortel, carasse sans chair et corps sans âme.
Les illustrations étaient superbes, signées de Bilibine, et je ne résiste pas à l’envie de lui rendre hommage en image.
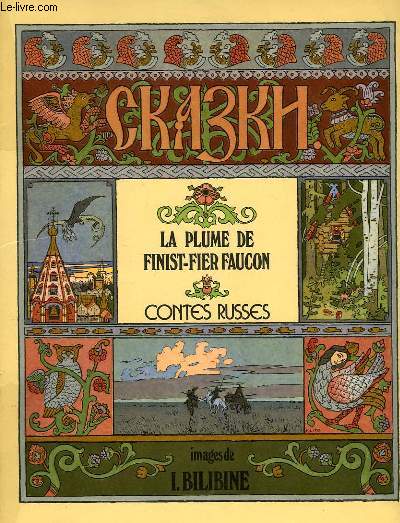
Dans ces livres, tout concourait à produire un dépaysement. La couleur du papier, la décoration des pages de texte, les illustrations elles-mêmes et la langue. On y trouvait des joyaux, avec de superbes dialogues parfumés d’expressions exotiques.
« Dans les temps jadis, o ne sentait jamais l’odeur de Russe par ici. Et voilà que l’odeur russe par le monde se promène, dans ma maison traîne, à plein nez m’enchifrène! Que fais-tu là, jeune fille ? Tu éprouves ton courage ou tu fuis l’ouvrage ? »
« Hutte-chaumine, ne me fais pas grise mine, tourne-toi dos au bois, face à moi ! Chez toi, je veux monter, de ton pain-sel goûter. »

Je connaissais ces contes par coeur, je pouvais les raconter sans les livres et en découvrir des dimensions supplémentaires. Les contes russes étaient les seuls qui entraînaient et amusaient sincèrement les adultes dont les oreilles passaient par là. Et en cela ces contes ont constitué une référence de narration pour moi. Donner différents degrés de lecture, atteindre les enfants et leurs parents — car souvent les premiers lecteurs des contes sont des parents. Quoi de mieux pour donner le goût à la lecture que lire avec gourmandise ?
Dans le cas de Hernig et Zebraël, c’est une pensée comparable qui m’a accompagné, parler à l’enfant dans l’enfant et à l’enfant dans l’adulte — la part d’enfant reste très développée chez moi. Pourtant, en parlant à l’enfant, je me refuse à être infantilisant. C’est pourquoi j’ai conservé des termes un peu rares, des imparfaits du subjonctifs et quelques structures de phrases qui réclament du jonglage. J’aime parler à l’intelligence des enfants, ils apprendront peut-être quelques mots, s’étonneront de quelques tournures, questionneront quelques rebondissements… et c’est tant mieux.
Petit, quand je lisais Baba Yaga disant : « Et voilà que l’odeur russe par le monde se promène, dans ma maison traîne, à plein nez m’enchifrène », j’ignorais royalement l’existence et la signification du verbe enchifrener. J’ai d’abord deviné de quoi il s’agissait approximativement. Puis un adulte est passé par là (et je dois dire que c’était également approximatif) puis est venu le dictionnaire.
Il y avait même quelque chose de ludique à raisonner quant à la signification d’un terme en fonction de son contexte… et la rime était si musicale, promène, traîne, enchifrène, aucun mot n’aurait mieux terminé cette phrase.
J’aime aussi le conte en tant que ce qu’il invite au rêve. Et j’espère, avec Hernig et Zebraël, inviter au voyage et inviter au rêve.
Comment la collaboration avec Beax (Béatrix de Gevigney) s’est-elle faite ?
J’avais écrit Hernig et Zebraël depuis quelques années quand j’ai rencontré Béatrix. Je le gardais précieusement en attendant de trouver quelqu’un pour l’illustrer. Béatrix travaillait dans la publicité, avec ma petite soeur Marion, elle y occupait une fonction de directrice artistique et illustratrice. Quand nous avons fait connaissance, chez Marion, nous avons assez vite cherché des manières de lier nos talents. Et nous avons d’abord travaillé sur des formats brefs, je signais un texte qui racontait l’histoire (fantasmée) d’un animal et elle l’illustrait.

Ici, en exemple, le grand bec du pélican dû au fait qu’il tournait sept fois sa langue avant de parler tout en ayant la bouche pleine. Puis, j’ai fait lire à Béatrix Hernig et Zebraël, qu’elle a immédiatement beaucoup aimé et qui l’a inspirée. C’était une grande entreprise, c’est un texte long, il réclamait une quinzaine d’illustrations, une étude de personnages, des décors et un ton cohérents. Quand elle eut terminé les trois ou quatre premières, nous sommes allés au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil (2015) et nous avons présenté le texte et les illustrations existantes à de nombreux éditeurs. Nous avons reçu un très bon accueil et c’est là que nous avons fait connaissance avec Valérie Cussaguet, éditrice des Fourmis Rouges. Un an plus tard, le livre existe et nous venons de le dédiacer lors de l’édition 2016.
Peux-tu nous parler d’éventuels projets à venir ?
Je travaille actuellement sur trois projets déjà avancés.
Les Parias de Babylone
Roman qui raconte les aventures d’une population d’exclus née à Babylone il y a 38 siècles et de la contre-culture qu’ils ont bâtie et qui a perduré jusqu’à aujourd’hui.
www.lespariasdebabylone.com
Héros
Bande-dessinée dystopique en trois tomes qui conduit le lecteur dans un monde où se rejoignent des atmosphères médiévale, steampunk et végétale, soit, en un mot, biopunk.
www.victorboissel.com/i1.html
Sans titre pour le moment
Un nouveau conte… dont je ne dis rien encore pour le moment ;p
Et, en parallèle de ces projets, d’autres textes imprévus s’invitent dans mon emploi du temps en passant gaiement devant les autres. Comme L’histoire d’Ariane, une nouvelle que j’ai écrite récemment dans le cadre d’un recueil dont les bénéfices seront reversés à une association dont l’objet est l’alphabétisation des femmes. Ainsi qu’un petit roman qui me réclame de l’attention ces derniers temps et qui risque, lui aussi, de griller quelques priorités.
Pour finir, quels classiques conseillerais-tu à quelqu’un qui souhaiterait se lancer dans l’écriture ?
Le premier conseil que je donnerais est celui d’apprendre à se connaître. Quelqu’un qui veut écrire est d’abord un lecteur. C’est un lecteur des autres qui envisage d’être un lecteur de lui-même.
Et il n’y a rien de plus différent d’un lecteur qu’un autre lecteur. Aussi, et pour apprendre à se connaître, je conseille à quelqu’un d’aller dans ce qui lui plaît sans enfermer ce qui lui plaît entre des murs qui s’appellent genre ou auteur. Par exemple, Maupassant m’a ankylosé d’ennui avec Une Vie alors qu’il m’a profondément enchanté avec Bel-Ami.
Pour recevoir un conseil avisé, il ne faut pas seulement qu’il provienne de quelqu’un qui connaît bien la littérature, il faut qu’il provienne de quelqu’un qui connaît bien le destinataire de ce conseil.
Je ne dirais pas cela si j’avais aimé tous les livres dont on m’avait juré, la main sur le coeur, qu’ils étaient merveilleux. Ce n’est pas le cas. Et j’ai ensuite appris à ne pas suivre la plupart des conseils. Quand j’ai compris la phrase de Jacques Salomé : « Un livre a toujours deux auteurs : celui qui l’écrit et celui qui le lit. »
Ce que je peux éventuellement proposer, c’est que si quelqu’un lit ces lignes et s’y retrouve, je lui fasse part de textes qui m’ont conquis. Alors, et dans le désordre, il y a ceux que j’ai cités aux questions précédentes et quelques autres : L’Étranger de Camus, Les Rois maudits de Druon, La Faim du tigre de Barjavel, Antigone d’Anouilh, Zadig de Voltaire.
Pour en savoir plus :
Hernig et Zebraël de Victor Boissel et Beax, Editions Les Fourmis rouges, 84 pages, 22,50
Podcast : Hernig et Zebraël dans L’as-tu lu mon p’tit loup ? sur France Inter